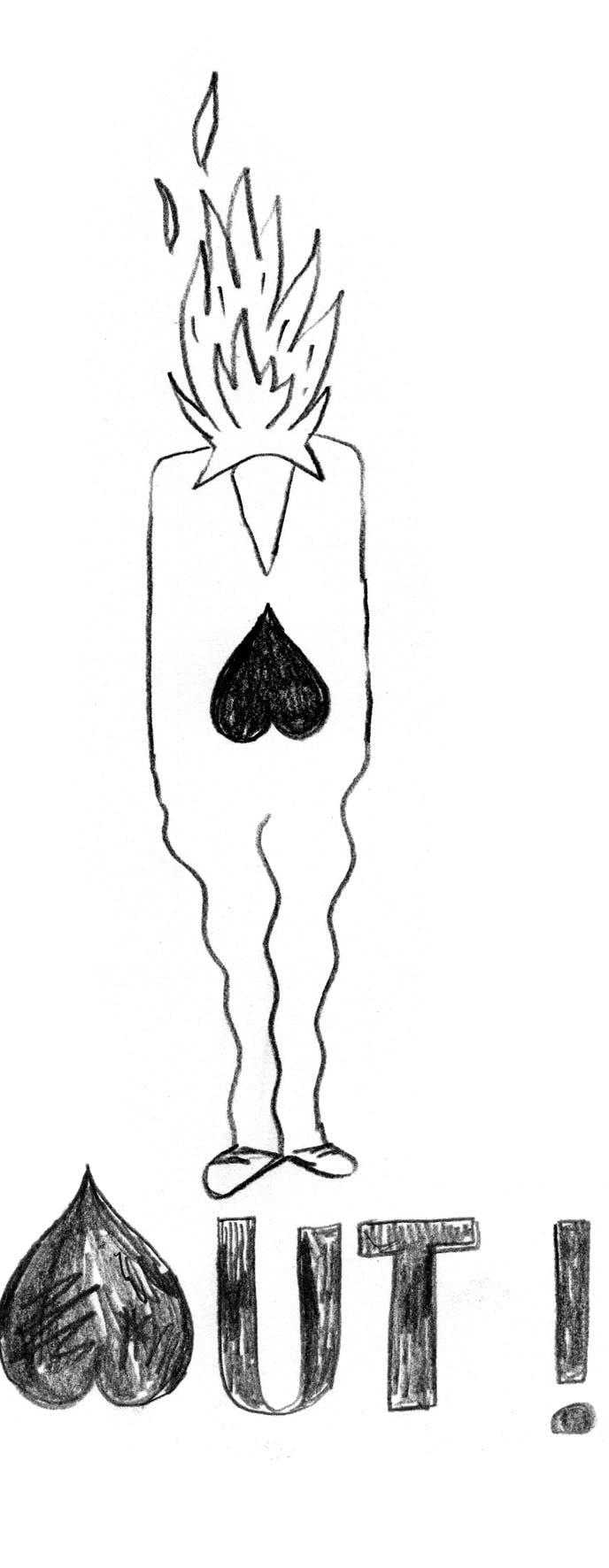
Burn-out : un signal pour repenser nos manières de vivre et de travailler
Le burn-out n’est pas qu’un drame individuel : c’est un signal pour repenser nos rythmes, nos organisations et notre rapport au travail.
mai 2025



octobre 2025

Vous connaissez sans doute cette phrase attribuée à Peter Drucker. Même la meilleure stratégie échoue si la culture ne suit pas. Cela veut dire que peu importe à quel point votre stratégie d’entreprise est brillante, votre plan échouera sans une culture d’entreprise qui encourage les gens à la mettre en œuvre.
Malgré cette évidence, la culture reste traitée comme un détail. Comme si la manière dont les gens travaillent ensemble était secondaire.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 70 et 80 % des fusions n’atteignent pas les objectifs annoncés. Et ce n’est pas faute d’avoir mal audité les finances ou les contrats. C’est parce que la dimension culturelle, invisible et fragile, a été négligée.
Les exemples célèbres sont nombreux : Daimler-Chrysler, AOL-Time Warner… autant de fusions dont l’échec tient moins à la stratégie qu’à l’impossibilité de faire cohabiter deux cultures d’entreprise opposées.

Si j’ai décidé d’écrire sur la culture, c’est parce que j’ai accompagné de nombreux managers et équipes après des fusions. Et, à force, un constat s’impose : les mêmes phénomènes reviennent, encore et encore.
La direction, souvent, délègue l’opérationnel aux managers. Ces derniers, de leur côté, attendent des clarifications qui tardent à venir. Résultat ? Une surcharge de travail, une gestion permanente des urgences, des discussions menées dans le feu de l’action… et des lignes de communication qui se distendent.
Chacun peut encore parler avec son N+1 direct. Mais chaque binôme N/N+1 se retrouve englué dans le même problème. Alors, si vous regardez la chaîne dans son ensemble, vous voyez bien qu’il n’y a plus de fluidité. À première vue, chaque relation individuelle “fonctionne”. Mais, en réalité, l’ensemble du système se grippe. Chacun se sent coincé à un endroit du système en pensant que ce sont les autres qui dysfonctionnent.
Et ce n’est pas neutre. J’ai vu des personnes sombrer dans une souffrance profonde, parfois proche de la dépression, du désespoir ou de l’épuisement. Un sentiment d’être coincé dans un tunnel sans fin. C’est justement parce que j’ai été témoin de cette détresse que j’ai décidé d’entreprendre cette série d’articles. Pour offrir un peu de recul. Pour questionner et partager des repères à celles et ceux qui traversent le même labyrinthe, celui des réorganisations qui suivent une fusion-acquisition.
Et un paradoxe qui persiste
Depuis que je travaille dans le champ des organisations — d’abord en RH, puis dans le conseil et le coaching autour des transformations — je constate un paradoxe : chacun reconnaît que l’humain est clé mais il est rarement pris en compte… tant qu’il n’y a pas de crise.

En tant que coach, j’ai eu la chance d’accompagner de nombreuses équipes suite à des fusions ou réorganisation d’activité. Et parfois, certaines expériences marquent plus que d’autres. Celle-ci en fait partie. Elle illustre avec force ce qui se passe quand une entreprise n’anticipe pas ou pas adéquatement le changement culturel. Et elle est représentative de beaucoup d’autres situations que j’ai pu observer.
Dans ce cas précis, les tensions sont apparues très vite.
Considérez que le cas de deux sociétés qui partagent la même industrie, mais pas la même culture, ni les mêmes priorités.
Quand la plaine rachète la montagne
À première vue, tout semblait simple : deux sociétés du même secteur, des expertises proches, des métiers similaires. Pourtant, derrière les apparences, un gouffre invisible séparait A, la société de la plaine, et B, celle de la montagne.
Les gens de la plaine venaient d’un univers vaste, ouvert, structuré. Ils avaient l’habitude de décisions rapides, d’une vision large, presque horizontale et vendaient des produits à la grande distribution. Les gens de la montagne, des spécialistes, artisans, vivaient dans un autre rythme. Leur quotidien était fait de pentes abruptes, de contraintes fortes, d’une capacité d’adaptation forgée par des conditions difficiles, ils se concertaient parfois des jours entiers pour anticiper les besoins particuliers de leurs clients. Même industrie, oui. Mais pas la même manière d’avancer, ni la même culture pour décider et coopérer.
Des brouillards de communication
Dès les premiers mois, les tensions ont surgi.
Un manque de clarté, d’abord. Dans la plaine, on pensait donner des directions simples. Mais dans la montagne, ces décisions semblaient floues, parfois incohérentes. Les collaborateurs ne comprenaient pas pourquoi certaines orientations étaient prises. Et à chaque question, chacun donnait sa propre version. Résultat ? Plusieurs réponses différentes à une seule et même interrogation.
La flamme qui s’éteint
Peu à peu, la motivation s’est effritée.
Les équipes travaillaient encore bien, solides et professionnelles. Mais l’envie n’était plus là. Dans la plaine, on voyait une main-d’œuvre opérationnelle, qui avançait. Dans la montagne, on ressentait surtout une perte de sens, une impression d’avoir perdu le souffle de l’ascension.
Des moyens trop courts
La frustration des ressources s’est vite installée.
Les ambitions de la plaine étaient grandes, parfois immenses. Mais dans la montagne, on répétait que les moyens ne suivaient pas. L’expression revenait comme un refrain : “On nous demande de gravir une paroi avec un simple couteau.”, « on a perdu des années d’expertise », « nos clients ne sont plus traités comme avant et ils se plaignent », « je n’ai plus rien à faire dans la plaine, ou est ma valeur ajoutée », « les managers de la plaine ne comprennent rien et en plus ils sont mieux payés que nous »,…
Le décalage entre sommet et sentiers
Et puis, un autre écart est apparu, plus profond encore.
Le top management – le sommet de la plaine – avait décidé la fusion. Mais il en avait confié l’exécution aux managers intermédiaires en faisant un mix de managers provenant de la plaine et de la montagne, chargés de guider les équipes de montagne dans leur intégration. Avec, en plus, une injonction paradoxale : “Soyez créatifs, soyez positifs, trouvez des solutions.” Comme si l’optimisme seul suffisait à franchir les ravins et à combler les manques.
Derrière cette posture, un message implicite : tout ce qui ressemblait à un obstacle, une alerte ou une mauvaise nouvelle n’avait pas sa place. Dans la plaine, la culture valorisait la lumière, les discours positifs, les victoires rapides. Les voix de la montagne, qui signalaient la dureté du terrain, étaient vite perçues comme du négativisme.
Un fossé qui s’élargit
Alors beaucoup se sont tus. Les difficultés réelles restaient enfouies, exprimées à demi-mot. Le décalage entre ceux qui avaient décidé la fusion et ceux qui devaient la vivre au quotidien ne cessait de grandir.
Les quelques voix qui osaient encore remonter les obstacles étaient peu entendues. Le sommet de la plaine restait concentré sur sa mission : réussir la fusion, coûte que coûte. Les pierres et les pentes de la montagne étaient reléguées au second plan.
Isolement et désengagement
La culture, trop peu tournée vers la coopération transversale et verticale, a renforcé les silos.
Les équipes se sont retrouvées isolées, sans liens, parfois sans soutien. Certaines ont même choisi de quitter la cordée, sans regret.
Un climat lourd, presque étouffant
Le quotidien était marqué par une tristesse diffuse, une perte d’espoir.
Les collaborateurs avaient l’impression de tourner en rond dans la brume, sans jamais avancer sur les vrais enjeux. L’énergie s’épuisait. Le professionnalisme tenait encore, mais la cohésion s’effritait. Chacun avançait seul, dans son couloir, sans élan collectif.
Un appel à reconstruire des ponts
Au cœur de ce climat, les besoins se sont exprimés avec clarté.
L’équipe devenue mixte voulait un espace pour parler vrai, pour retrouver du sens et de l’énergie collective. Elle voulait aussi être impliquée dans la recherche de solutions concrètes.
Le manager, lui, demandait des repères solides : des plans de recrutement, des messages cohérents, des perspectives réalistes. Il cherchait à redonner espoir, visibilité et cohésion.
Et derrière ces demandes, une attente plus large : recréer des ponts entre plaine et montagne. Faire circuler la parole dans les deux sens. Ne plus laisser chacun enfermé dans sa vallée ou son couloir. Mais rétablir une ligne managériale vivante, fluide, animée d’un véritable esprit de collaboration.
Cet exemple montre bien ce qui se joue quand la dimension culturelle n’est pas anticipée. Un décalage s’installe à plusieurs niveaux :
· entre les attentes des collaborateurs (sens, clarté, énergie collective) et les moyens mis en place (budget, communication, organisation),
· mais aussi entre le top management, qui décide et impose un mandat clair, et les équipes de terrain, qui doivent exécuter sans que leurs difficultés ne soient vraiment entendues.
Et la demande centrale, ici comme ailleurs, reste la même : retrouver un alignement entre la culture, le management et les pratiques du quotidien. Pour redonner souffle. Pour retisser la cohésion.

Je me suis souvent demandé pourquoi les dirigeants n’avaient pas anticipé l’éléments culturel et humain, créateur de valeur. Cette question m’interpelle beaucoup car il semble y avoir un énorme angle mort, une non connaissance sur le sujet alors que la littérature et les expériences abondent sur le sujet.
Je refuse de penser que cet oubli est voulu ou provient d’une décision consciente. Après réflexion, partie de la réponse à cette question se retrouve dans nos biais cognitifs qui forgent les habitudes de fonctionnement des organisations. C’est donc une « limitation » de pensée qui impacte la vie et la performance de toute une organisation.
La psychologie nous donne quelques clés. Festinger, avec sa théorie de la dissonance cognitive, explique que nous avons tendance à minimiser ce qui contredit nos choix. Les dirigeants, déjà engagés dans une transaction risquée, préfèrent ignorer les signaux faibles culturels plutôt que de remettre en cause leur décision.
D’autres biais cognitifs sont applicables à notre sujet. Qu’en pensez-vous ?
Il s'agit de la tendance à survaloriser ce qui est concret, mesurable et quantifiable (comme les chiffres financiers) et à sous-estimer ce qui est immatériel et difficile à chiffrer (comme la culture).
Ce biais consiste à ne pas reconnaître ses propres biais ou à ne pas voir les problèmes qui sortent de son champ d'expertise habituel. Les experts financiers et juridiques qui pilotent les fusions sont formés pour se concentrer sur leurs domaines, ce qui peut créer un angle mort collectif sur les aspects humains.
Comment il se manifeste : Les équipes de M&A, composées d'experts en finance et en droit, ne sont tout simplement pas équipées ou entraînées pour évaluer la culture. Ce n'est pas qu'ils la nient, mais elle n'apparaît pas sur leur radar.
Ce biais pousse les individus à croire que les autres partagent les mêmes valeurs, croyances et comportements qu'eux. Dans le contexte d'une fusion, les dirigeants de l'entreprise acquéreuse peuvent inconsciemment supposer que la culture de l'autre entreprise est similaire à la leur ou qu'elle s'adaptera facilement.
Comment il se manifeste : Les dirigeants minimisent les différences culturelles en pensant "nous faisons tous des affaires de la même manière". Ils sous-estiment la singularité de la "secret sauce" de chaque organisation
Pourtant deux entreprises peuvent suivre la même stratégie, avoir les mêmes structures... elles ont néanmoins leur propre culture. C’est pourquoi la phase de "Diagnostic Culturel", qui vise à identifier les "écarts interculturels", est conçue pour contrer cette tendance à l'homogénéisation.
Ce biais conduit les décideurs à surestimer leurs propres capacités à gérer les défis futurs. Même conscients des risques culturels, ils peuvent croire que leur leadership ou la solidité de leur plan stratégique suffiront à surmonter les obstacles humains.
Comment il se manifeste : Les dirigeants pensent qu'ils pourront "gérer" la culture après la fusion, une fois les aspects "sérieux" (financiers, légaux) réglés. Ils sous-estiment la complexité et la résistance au changement des systèmes humains.

J’en conclu que la négligence de la culture dans les fusions n'est pas simplement un oubli, mais le résultat de biais cognitifs puissants qui privilégient le mesurable sur l'immatériel, créent des angles morts dans l'analyse de risque, projettent une fausse similarité et nourrissent un excès de confiance dans la capacité des dirigeants à gérer l'intégration humaine a posteriori.
Résultat ? Les coûts financiers et humains explosent plus tard : démotivation, conflits ouverts, retraits, démissions, perte de talents, non livraison de projets, retards, perte de clients,….
Dans les prochains articles, je vous propose de plonger plus en profondeur.
D’abord, nous prendrons le temps de clarifier ce que recouvre réellement la notion de culture d’entreprise. Car derrière ce mot souvent galvaudé se cache une réalité beaucoup plus concrète qu’il n’y paraît.
Ensuite, nous verrons les conséquences très concrètes d’un “fit” culturel mal anticipé : perte d’engagement, silos, désalignement managérial… Nous partirons d’exemples vécus pour montrer comment ces tensions se traduisent au quotidien.
Enfin, nous ouvrirons un troisième volet, plus tourné vers l’action : comment agir en amont pour transformer la culture en levier plutôt qu’en contrainte ?
Nous irons chercher des pistes concrètes, et nous partagerons aussi des best practices d’intégrations culturelles réussies.

Vous avez aimé cet article ?
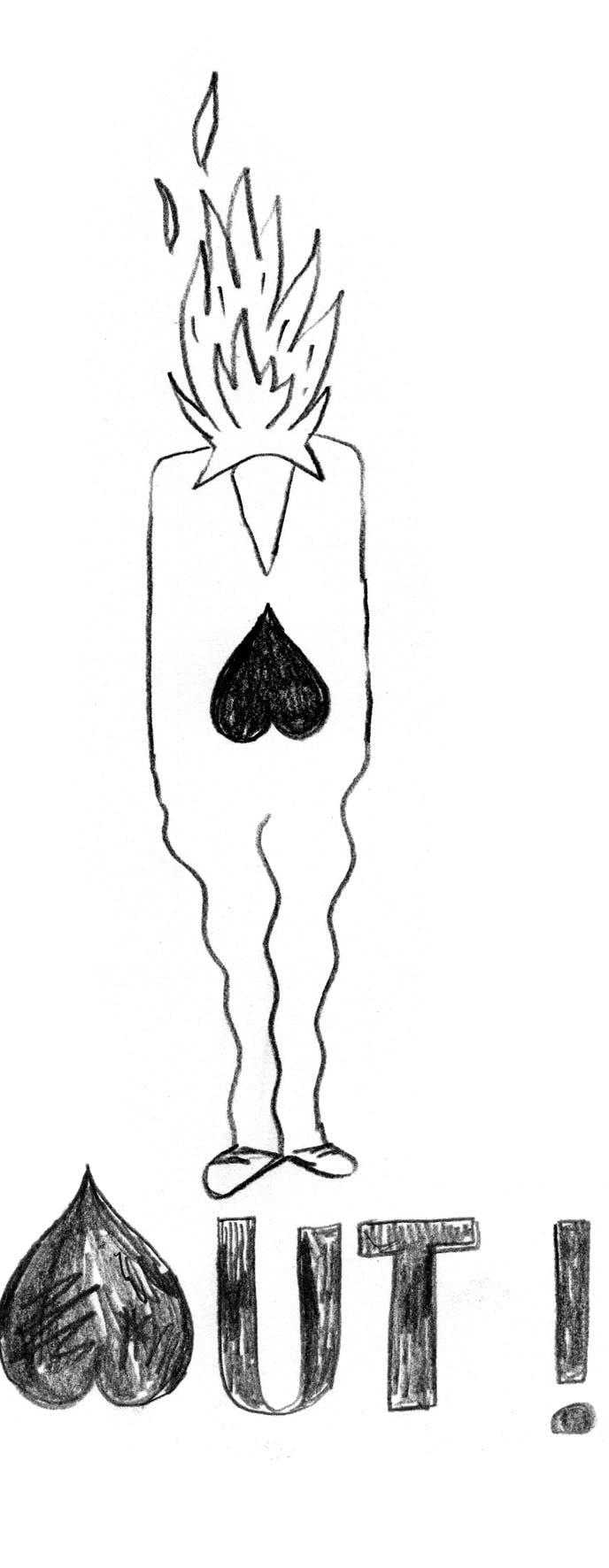
Le burn-out n’est pas qu’un drame individuel : c’est un signal pour repenser nos rythmes, nos organisations et notre rapport au travail.
mai 2025

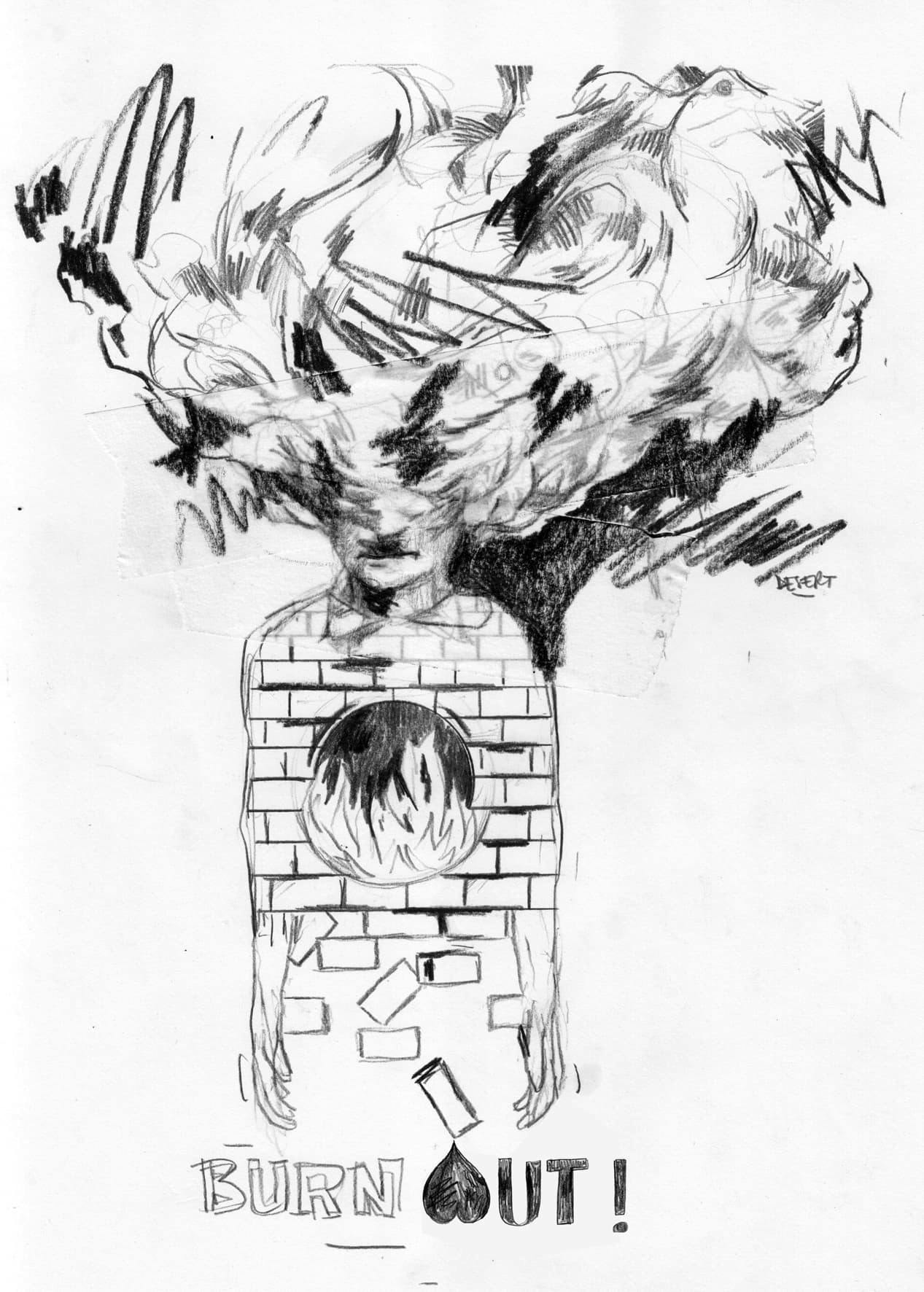
Pas de chiffres officiels au Luxembourg, mais des enquêtes alarmantes. OMS, Gallup, McKinsey, débats au Parlement : que disent vraiment les données ?
mai 2025


Qu’est-ce que le burn-out ? Définition claire, signes à repérer et témoignages vécus pour comprendre l’épuisement professionnel et mieux le prévenir.
mai 2025
